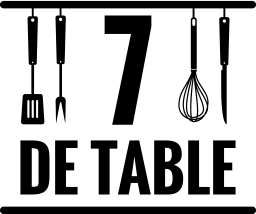Patrice Demers est une star à Montréal. Dans sa pâtisserie, il nous accueille avec un délicieux kouign-amann pêche/gingembre et un ultra moelleux financier au sucre d’érable et à la farine de sarrasin. Il a les mains dans le sucre depuis 20 ans, il va en avoir 40. Rencontre avec l’un des chefs pâtissiers les plus créatifs du Québec.

Patrice Demers - Photo 7 de Table.com
Vous avez commencé votre parcours professionnel par la cuisine pour bifurquer, par la suite, vers la pâtisserie. Racontez-nous cela.
Je ne viens pas d’une famille où la cuisine et la restauration occupent une très grande place, même si l’on a toujours très bien mangé à la maison. Je n’ai pas le souvenir d’une grand-mère qui fait des gâteaux. Mes grands-parents étaient assez âgés, mes parents m’ont eu tard. J’ai connu mes grands-parents à une époque où ils ne cuisinaient plus et ma mère ne faisait pas de pâtisserie. On mangeait simplement et moi je mangeais peu de choses. Très peu de légumes, les tomates n’étaient qu’en sauce et je mangeais quelques champignons. C’est une époque où les façons de travailler n’étaient aussi pas les mêmes, les brocolis, les choux-fleurs, tout était cuit au micro-ondes pendant 15 minutes, ça sortait mou, brun et pas assaisonné. Peut-être que j’avais déjà le goût un peu développé… À l’époque, aussi, je n’aimais pas les desserts, j’avais la dent très peu sucrée.
Comment cela est-il arrivé, alors ?
Je ne sais pas. À l’adolescence, je me suis mis à écouter des émissions de cuisine et à être fasciné par les restaurants. Même aujourd’hui, ce sont les restaurants qui me fascinent, plus que les chefs… J’aime aller manger au restaurant, c’est cela qui m’a donné envie de faire ce métier-là. J’ai compris qu’en pratiquant le métier, je pourrais côtoyer des chefs que j’admire, que je pourrais voyager et aller au restaurant. Avant, je m’étais inscrit en fac de psycho. Ayant une famille de profs, je me voyais aller vers l’enseignement, mais ma passion pour la cuisine commençait à grandir. J’ai commencé à cuisiner par nécessité des plats que je voulais manger. Et la décision s’est prise sur les bancs de l’université… dès la première journée ! Tous les étudiants étaient dans l’auditorium, les recteurs commençaient à parler du nombre d’années que nous allions faire… et à un moment j’ai commencé à décrocher, j’ai pensé à de la nourriture ! Dix minutes plus tard, je me suis dit que je n’étais à ma place. Le lendemain, j’ai annulé mon inscription à l’université. Je voulais m’inscrire à l’ITHQ (Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec) de Montréal qui était complet, forcément, nous étions au mois d’août, et je tombe par hasard sur une petite annonce dans le journal où je vois qu’il y a des places en pâtisserie à l’ITHQ de Laval. Quitte à perdre une année, je vais faire ça. Je m’y connaissais très peu en pâtisserie, j’avais déjà plus quelques connaissances en cuisine. Au même moment, en allant un soir manger au restaurant avec ma mère, le chef passe en salle. Je lui pose une question, je lui dis que je fais l’école hôtelière. Il m’invite à venir passer une journée d’observation, il m’y fait un peu travailler et à la fin de la journée, il m’offre un emploi à temps partiel. J’ai commencé les deux en même temps. Je faisais un peu les entrées et j’aidais aussi aux desserts. Le premier jour dans cette cuisine, j’ai su que j’étais au bon endroit. Je suis bien tombé, la cuisine était petite, mais tout était fait maison et le chef très impliqué. Aujourd’hui, le chef est devenu un ami, nous sommes restés très proches.
Êtes-vous venu en France pour apprendre quelques techniques, comme beaucoup de chefs dans le monde ?
Non. J’aurais voulu faire quelques stages, mais j’ai toujours eu un emploi. Avec un profil comme le mien, pâtissier/cuisinier, que l’on voit moins souvent au Québec, le mot s’est passé et j’ai fait beaucoup d’ouvertures de restaurants. Je suis souvent tombé sur de beaux projets qui ont fait parler d’eux… Mais après avoir travaillé dans deux bons restos en ville, en 2001, je suis parti à 21 ans avec un ami, un restaurateur assez connu, Claude Beausoleil, pendant 31 jours en France - c’est lui qui a lancé le chef normand Laprise dans son restaurant Citrus, très connu à Montréal - avec le but d’ouvrir un restaurant à notre retour. Nous voulions voir ce qui se faisait en France. Alain Passard à l’époque venait de laisser tomber la viande pour passer aux légumes, et Claude Beausoleil était convaincu que l’avenir était aux légumes, ce qui en 2001 était plutôt audacieux…
Oui, la culture alimentaire québécoise/canadienne est véritablement axée sur les protéines animales, c’était d’autant plus compliqué, j’imagine…
C’est vrai. En ce moment, on voit un changement s’opérer dans les grandes villes mais pas encore partout au Québec. Les protéines animales deviennent tellement dispendieuses et les gens s’aperçoivent aussi qu’ils doivent changer leurs habitudes alimentaires…
Alors, ce voyage en France ?
Nous avons fait une vingtaine de grands restaurants : Marc Veyrat, Michel Bras, Michel Trama. Nous sommes aussi allés en Espagne, chez Martín Berasategui qui venait d’avoir ses trois étoiles, et nous sommes remontés jusqu’à Paris pour l’apothéose : Alain Passard, Alain Ducasse et Pierre Gagnaire, 9 étoiles en deux jours. Nous avons quand même alterné avec des restaurants plus simples, des visites de marchés, de pâtisseries… Ça a été pour moi un cours accéléré de gastronomie ! C’était aussi ma première fois en Europe et ça commençait fort. Les voyages, les restaurants, c’est encore aujourd’hui ce qui motive mes vacances.
Est-ce que justement le fait que vous ayez commencé par la cuisine vous a fait envisager la pâtisserie d’une manière différente ?
Clairement ! Je pense que je travaille la pâtisserie d’une manière complément différente de ce qui est classiquement fait en France. Je me souviens qu’à l’école hôtelière, je recevais le magazine Thuriès et je lisais les articles de Philippe Conticini. Il parlait régulièrement de « l’assaisonnement des desserts ». Personne ne m’en avait parlé ! Quand on goûtait un dessert, on pouvait ajouter de l’acidité, du sel, du poivre, des épices, des herbes, et qu’il fallait le faire, pas seulement que l’on pouvait le faire ! Après, j’avais déjà vu ça en cuisine. Je savais que les carottes ne goûtent pas toujours la même chose. Et j’ai commencé à faire cela en pâtisserie. Comme je n’aimais pas cela quand j’étais enfant, j’ai travaillé la pâtisserie que je voulais manger et je me suis épanoui dans la pâtisserie de restaurant pendant 15 ans (ndlr : Patrice Demers est passé par les restaurants Chez L’épicier, Le Leméac, Les Chèvres dont il a été copropriétaire pendant trois ans, à seulement 23 ans)…
Le succès a été très rapide !
Oui. C’est monté très vite à cette époque-là ! Je me suis retrouvé le seul en ville à être autant médiatisé. J’ai publié mon premier livre de recettes, j’ai été invité à des émissions de cuisine… Quand j’étais enfant, j’étais obsédé par la magie, et même si j’étais très timide, parler en public ne me dérangeait pas. Après j’ai fait un deuxième livre, un troisième, là je termine mon quatrième livre qui sortira à l’automne. J’ai eu ma propre émission de télévision pendant cinq saisons. J’ai eu la chance que cette émission soit produite par Ricardo Larrivée qui est un peu le Cyril Lignac québécois. J’étais bien entouré…
Chose normale, vous recommandez de cuisiner « de saison », est-ce possible en pâtisserie de faire de même ?
J’ai toujours fait un effort là-dessus. Mais après, la réalité, c’est que nous sommes au Québec. Donc, l’hiver, je dois présenter quelque chose à mes clients. Je n’ai aucun intérêt à leur servir de la framboise de Californie qui est insipide. Mais je vais utiliser des agrumes qui, bien évidemment, ne viennent pas du Québec, mais qui sont plus logiques pour moi. Je vais me permettre aussi quelques fruits exotiques. En saison, lorsque j’ai les produits à portée de main, je vais travailler de la fraise ou de la framboise du Québec. C’est quelque chose qui m’a été inculqué par les chefs avec qui j’ai travaillé. Ici, l’hiver c’est très difficile surtout la fin de l’hiver - mars, avril, même mai - avant que les premiers fruits et légumes commencent à pousser, on n’a presque rien. Mais on a une qualité de produits assez extraordinaire, sinon.
De ce que je sais, les jeunes chefs québécois redécouvrent leur terroir depuis peu, une petite trentaine d’années. Commence est-ce que cela se traduit-il dans la pâtisserie en général et dans votre cas en particulier ?
Oui, depuis trente ans, quelque chose s’est opéré. Je suis arrivé dans cette époque-là, j’ai vu ce changement qui avait commencé un peu avant. Pour l’exposition universelle de 1967, plein de chefs de par le monde sont arrivés à Montréal, des chefs européens et ce sont eux qui ont amorcé ce changement. Un nom qui revient souvent, c’est Jean-Paul Grappe, un chef français qui s’est installé au Québec à l’époque de l’expo, il était responsable cuisine du Pavillon de la France. Il est tombé en amour du Québec et est resté ici. C’est lui qui a fait découvrir aux Québécois les produits qui étaient ici. Il voyait des produits que personne ne mangeait comme les oursins, par exemple, ou encore les couteaux.
Et par rapport aujourd’hui à la pâtisserie ?
Les desserts québécois sont très simples et la pâtisserie est vraiment française. Ce sont des desserts très très rustiques. Le niveau de vie des Québécois et des Canadiens francophones était très modeste. Le dessert phare est le « pudding chômeur » qui a été créé dans les années 30, à l’époque de la Grande récession, les gens n’avaient plus d’argent. Le sucre blanc était cher, la cassonade l’était moins. On a créé ce dessert tout simple avec des oeufs, de la farine, du lait et de cassonade. C’est devenu le dessert emblématique du Québec. Quand l’argent est revenu dans certaines familles, le sirop d’érable est apparu. Après, nous sommes dans une dualité de culture britannique et de culture française. Au niveau du dessert, les influences britanniques sont très fortes dans les desserts traditionnels, la pâtisserie française est arrivée plus tard. Quand nous faisions des desserts à la maison, c’était plutôt ceux d’origine britannique, et quand nous voulions nous gâter, nous allions dans une pâtisserie française pour acheter des éclairs ou des mille-feuilles. Mais personne n’imaginait les refaire à la maison… Aujourd’hui, certains de mes clients plus âgés, ne comprennent pas que je suis québécois et que je fais ce genre de pâtisserie. Pour faire de la pâtisserie française, il fallait être français…
Les desserts traditionnels comme le pudding chômeur ou la tarte au sucre, ce sont des choses que vous retravaillez ?
Cela nous sert de point de départ, en effet. Après, le pudding chômeur c’est un peu moins moi, parce que tout le monde le retravaille. Mais ici, à la boutique, nous avons remplacé le sucre par le sucre d’érable qui est plus québécois. Même si mes grands-parents ne savent pas ce qu’est un financier, ma recette au sucre d’érable leur aurait beaucoup parlé. Et même, pour le sarrasin que j’utilise. Dans les années 60, il y a eu des pénuries de farine de blé, et l’on s’est mis à beaucoup travailler le sarrasin, c’est un peu ce qui a sauvé le Québec de la famine. Ici, on faisait une galette plus épaisse que la galette bretonne - c’est plus comme un pancake - et on l’arrosait soit de sirop d’érable pour les plus… nantis, soit de sirop de poteau. C’est du sirop de maïs brun, c’est un faux sirop d’érable. Quand on sort de Montréal, souvent dans les Casse-Croûtes [ndlr : type de restaurants rapides très courant au Québec], sur la table, il y a souvent du sirop de maïs…
Quels sont les produits que vous utilisez et que les autres pâtissiers québécois ne vont pas forcément utiliser ?
Il y a des choses que j’ai un peu toujours utilisées dans mes pâtisseries, ce sont les légumes. Ce n’est pas pour provoquer, mais pour moi certains légumes font sens. On fait, par exemple, un sorbet carotte et argousier. Le fenouil, je voyais les chefs utiliser les bulbes, mais laisser les branches. Je me suis mis à les couper finement, à verser un sirop sucré avec une bonne dose de citron dessus, puis à l’intégrer à des salades de fruits. Ce sont des choses que les pâtissiers de restaurant vont utiliser, mais que l’on voit moins en boutique. Quand on décide de mettre des champignons dans un dessert, il faut que ce soit très très très bon. J’avais présenté une recette à Omnivore avec des noix de pécan, canneberges, sirop d’érable, et… champignons sauvages ! Ce sont deux champignons du Québec qui, une fois séchés, ont des arômes de sucre d’érable et de noix. C’est un dessert que j’aime beaucoup, très automnal, avec des produits de saison.
Vous avez créé un gâteau spécial pour les 375 ans de Montréal à qui vous avez offert officiellement la recette. Quel goût a ce gâteau et pourquoi l’avoir créé avec ces produits bien spécifiques ?
La ville avait faire une sorte de concours. J’avais fait une proposition qui a été retenue. Il y avait du sarrasin, de la bière noire d’une micro-brasserie, du chocolat qui représentait le côté français. Il y avait aussi un crumble à la mélasse qui est très importante dans l’histoire de Montréal.
Aujourd’hui, est-ce que l’on peut tracer les grandes lignes d’une pâtisserie québécoise ?
Il y a quelque chose qui commence à s’installer. Je ne suis pas le seul à travailler les produits du Québec. Je ne suis pas le seul à puiser dans mes souvenirs d’enfance. Rémy Couture, un ami pâtissier qui a un style extrêmement différent du mien, fait des petits gâteaux que l’on mangeait quand on était enfant. Cela touche les Québécois, cela permet de rendre accessible la pâtisserie haut de gamme.
On vous compare à un futur Pierre Hermé, comment est-ce que vous comprenez ceci ?
Pour les gens ici, c’est une référence en France. Les premiers livres que j’ai lus - même si je suis un grand fan de Conticini -, mes premières références en pâtisserie, ce sont les livres de Pierre Hermé. C’est avec lui que j’ai découvert une pâtisserie un peu créative, où il utilisait des légumes. Une pâtisserie avec une vraie liberté, celle de mettre de la rose dans un dessert, ce que l’on faisait dans d’autres cultures dans le monde, mais qu’en France, personne n’avait jamais oser faire. C’était révolutionnaire !
Quelle est la pâtisserie dont vous êtes le plus fier ? Et celle où vous vous posez encore des questions ?
Le financier à l’érable, c’est quelque chose de simple, que j’aime et qui représente bien mon travail, quelque chose de plus rustique. De plus en plus, je m’en vais vers le travail de la viennoiserie qui m’intéresse finalement plus que les gâteaux très complexes. J’ai un autre dessert signature qui n’est ni avec des produits de saison ni avec des produits du Québec. On l’offre ici à l’année, c’est un dessert à l’assiette : le « Vert ». Nous allions ouvrir un nouveau resto au début du printemps, il n’y avait pas de produits intéressants au Québec. Je voulais un dessert tout en fraîcheur pour mon menu, je suis parti sur la couleur « vert ». J’avais vu Pierre Gagnaire faire un travail sur le rouge en salé, je me suis dit que j’allais faire le vert en sucré. J’ai fait une liste d’ingrédients : pomme verte, herbes, pistache, c’est un dessert qui est arrivé rapidement. Souvent, c’est le dessert que je fais quand on reçoit des chefs. C’est le dessert pour lequel j’ai eu le plus de retours positifs. Des gens comme Pascal Barbot (Ndlr : chef de l’Astrance, restaurant 3 étoiles Michelin à Paris) m’ont dit qu’il se passait quelque chose à la dégustation. J’en suis très fier ! Sinon, je n’ai pas osé m’attaquer encore aux… croissants ! On me le demande souvent, mais quand je décide de faire quelque chose, je veux que ce soit la meilleure version que je puisse faire. Ça va être plusieurs mois de recherche…
Nous avons dit que vous avez un nouveau livre qui sort bientôt…
Oui le livre, on pourra le trouver en France à la Librairie Gourmande, à Paris. Je me suis dit que cela faisait déjà 20 ans que je faisais de la pâtisserie et l’on m’associe toujours à un « jeune » pâtissier. J’ai voulu parler de mon parcours et des gens qui m’ont inspiré. Dans le livre, je présente 14 personnes, des restaurateurs et des producteurs avec qui je travaille en étroite collaboration depuis plusieurs années.
Je crois aussi que vous avez fait une collaboration pour Noël, en France, avec Ladurée, c’est bien ça ?
Comme l’an dernier, Claire Hetzler est partie, ils ont prévu de faire des collaborations avec des chefs pâtissiers dans le monde. Il y a eu l’an dernier un chef norvégien. À Pâques, ils ont demandé à Mori Yoshida (chef japonais de la pâtisserie parisienne éponyme) et là, pour Noël 2019, ils ont voulu un chef canadien, ils m’ont demandé…
Merci. On en reparlera le moment venu !
Patrice Pâtissier
2360, rue Notre-Dame Ouest
Local 104, Montréal
(Québec) H3J 1N4
Mots-clés : Montréal Pâtissier - Patrice Demers - Sirop d'érable